1717 l’histoire volée des francs-maçons de André Kervella – (La Pierre Philosophale – 15 mai 2017)
L’histoire officielle de la franc-maçonnerie fait commencer cette institution en 1717, avec la fondation de la Grande Loge de Londres. C’est un mythe.
La Grande Loge de Londres serait à l’origine des autres premières Grandes Loges continentales. C’est un autre mythe.
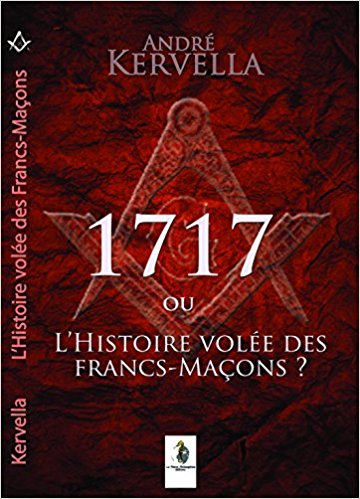 L’histoire réelle montre que les premiers francs-maçons sont apparus au XVIIe siècle, dans les îles Britanniques, au moment de guerres civiles.
L’histoire réelle montre que les premiers francs-maçons sont apparus au XVIIe siècle, dans les îles Britanniques, au moment de guerres civiles.
Ils étaient partisans de la dynastie Stuart, chassée du pouvoir en 1688. Parce que vaincus, malgré plusieurs tentatives de reconquête, ils sont désormais oubliés.
Et leur histoire leur a été volée !
Pis encore, les francs-maçons français qui leur doivent leurs premières loges et leurs premiers grands maîtres, font comme s’ils n’avaient jamais existé.
André Kervella montre dans cet ouvrage comment se sont donc construits ces mythes pourtant aujourd’hui présentés comme des vérités indubitables, voire scientifiques.
Il propose également une analyse des conditions dans lesquelles certaines obédiences françaises actuelles revendiquent une authenticité qu’elles ne peuvent avoir, tout en s’efforçant de masquer les contradictions qui encombrent leur propagande.
Les derniers chapitres invitent à une réflexion sur la crise du sens et des valeurs qui affectent l’Ordre. Face à la dislocation de l’Universel, comment concevoir le maintien d’une fraternité active et des démarches initiatiques personnelles pertinentes ?
Entretien accordé de la part d’André Kervella à nos éditions sur la publication prochaine de son nouvel ouvrage en date du 08/03/20107.
André Kervella, vous allez prochainement nous proposer un nouvel ouvrage sous le titre 1717 -L’Histoire volée des francs-maçons. La première question qui me vient à l’esprit est : pourquoi ce titre ?
Entendons-nous d’abord sur la signification du mot vol. Il y a vol quand quelqu’un s’approprie un objet qui ne lui appartient pas. Quand il le dérobe à quelqu’un d’autre. Il peut aussi y avoir vol quand quelqu’un s’attribue un acte souvent élogieux qu’il n’a pas commis. On l’a bien vu au lendemain de la dernière guerre mondiale quand certains résistants de la dernière heure se sont empressés de mettre à leur compte des faits d’armes de certains autres malheureusement morts dans l’action et ne pouvant alors protester. Dans une compétition sportive on parle aussi de victoire volée quand un athlète remporte un trophée par la feinte, la tromperie, comme en se dopant. Enfin, mais je n’épuise pas la gamme des expressions possibles, voler la vedette manifeste une propension à tourner les projecteurs vers soi sans les mériter.
En parlant quant à moi d’histoire volée, je veux signifier qu’il y a une tendance massive en historiographie à imposer une histoire officielle en la prétendant authentique, unique et universelle, alors qu’elle est le résultat d’un montage destiné à abuser les crédules. Pour que vous compreniez bien le phénomène, je renvoie à ce que l’anthropologue Jack Goody dit du vol de l’histoire accompli par les Européens après la Renaissance. Dans la littérature classique, il est fréquent d’affirmer que les principales découvertes ayant bouleversé le cours des civilisations ont été faites en Europe, et que l’Europe s’est imposée dès le siècle dit des Lumières comme un modèle pour l’ensemble de la Planète. Dans ce cas, les Européens ont considéré que c’était leur histoire qui expliquait celle de l’humanité tout entière. Ils ont tendance à le considérer encore. D’où leur penchant à nier l’histoire des autres, voire à penser que les non Européens n’ont pas d’Histoire, celle qui serait la grande Histoire, avec une majuscule, comme on l’a vu avec le président Nicolas Sarkozy en juillet 2007, à Dakar, quand il s’est cru autorisé à dire que l’homme africain n’était pas entré dans l’Histoire. De ce point de vue, le vol de l’histoire est la minoration, la marginalisation, l’effacement des autres histoires pour ne valoriser que la sienne, et c’est parfois dérober aux autres leurs propres découvertes pour s’en proclamer l’auteur.
Eh bien, en franc-maçonnerie, le vol de l’histoire est perpétré quand vous lisez dans les ouvrages de vulgarisation, et même dans d’autres qui se prétendant scientifiques, que la franc-maçonnerie est apparue en 1717, que ce sont les Anglais qui l’ont créée et que le reste du monde, le continent européen d’abord, n’a fait que jouer l’imitation. Ce vol-là participe de la dénégation d’une réalité complexe où les jacobites qui n’étaient pas tous Anglais, loin de là, sont rabaissés au rang d’acteurs de troisième rôle, voire de simples figurants tard venus dans l’histoire. C’est ainsi qu’on va assister bientôt à une vaste escroquerie intellectuelle, quand on va voir se déployer des commémorations de la naissance de la première Grande Loge de Londres. Trois siècles, cela se fête, non ? Je pense qu’il est superflu de m’étendre ici sur la place au contraire capitale tenue par les jacobites avant 1717. J’en parle suffisamment dans mes autres ouvrages, et je constate d’ailleurs que la recherche progresse de façon positive pour leur reconnaître le mérite d’avoir été des précurseurs. Mais, enfin, en observant l’agitation qui règne dans les hautes sphères de la franc-maçonnerie, je constate qu’il y a beaucoup de chemin à faire avant qu’on en vienne à une présentation moins idolâtrique et drolatique des Londoniens de 1717.
En résumé, l’histoire actuellement valorisée est celle des vainqueurs politiques, les Hanovriens, qui ont triomphé des jacobites pour maintenir au pouvoir la dynastie des Hanovre depuis 1714. Cette victoire politique a retenti sur la culture maçonnique, en éliminant du champ mémoriel tout ce que ces jacobites avaient pu construire avant. Et il y a pis. On sait fort bien que ce sont des jacobites qui ont transporté la franc-maçonnerie en France. La preuve en est administrée quand il s’avère que les premiers grands maîtres de la première Grande Loge de Paris sont tous des jacobites jusqu’en 1738. Mais l’idéologie dominante fait semblant de considérer que cette évidence est totalement subalterne. Certains audacieux vont même jusqu’à prétendre que ces premiers grands maîtres jacobites ont été initiés à Londres. Ce qui est le comble de la supercherie.
Mais je ne limite pas mon travail à ce phénomène centré sur les jacobites. J’évoque aussi les tours de passe-passe qui sont accomplis dans de nombreux manuels de vulgarisation, surtout en France, quand on fait de la République l’horizon politique de la franc-maçonnerie. Ce n’est pas que je récuse la République, loin de là ; c’est que je trouve particulièrement audacieux, voire arrogants les discours qui consistent à dire que la franc-maçonnerie porte en germe, si j’ose dire, le mode de fonctionnement républicain. Ce qui est un comble quand on la conçoit comme un Art Royal, né au cœur d’une monarchie.
Le questionnement des rapports de la franc-maçonnerie à un régime gouvernemental déterminé est souvent biaisé parce que, tout en simulant l’indifférence ou la neutralité, les loges sont très attentives à l’agitation du monde qui leur est extérieur. La mise à distance de la religion et de la politique, l’abandon des métaux à la porte du temple, l’exhortation à ne pas débattre des questions qui peuvent diviser au lieu de rassembler, tout cela a du sens. Mais sommes-nous sûrs, vraiment, d’être neutres ? Refuser de débattre est une chose, autre chose est d’importer dans les loges, consciemment ou non, des préconceptions ou des convictions forgées au-dehors. L’équivoque est flagrante quand on a vu récemment, à la fin février, le président François Hollande, déclarer haut et fort que la franc-maçonnerie française a toujours soutenu les programmes politiques républicains, ce qui pousse aux oubliettes tout ce qui a été fait sous l’Ancien régime, l’Empire napoléonien et la Restauration.
Est-ce pour cela que vous suggérez que le vol de l’histoire s’accompagne de la création de mythes ? Votre sous-titre est Mythologies de notre temps. Nous serions en plein dans le mythe, tout en croyant en être sortis ?
Oui et non. Oui, en ce que le vol de l’histoire entraîne des récits qui ne peuvent pas s’empêcher de jongler avec les mensonges, les contrevérités, les falsifications, le déni. Dans ce cas, on use et abuse de mythes, au sens de discours visant à présenter des faits imaginaires comme s’étant réellement produits. Ou bien, on dénature des faits réels, on leur impose des altérations plus ou moins importantes pour les faire coller à l’image laudative qu’on veut imposer à la postérité. Curieusement, ces deux manipulations visent à construire une sorte d’histoire idéale de la franc-maçonnerie qui donnerait aux Frères et aux Sœurs d’aujourd’hui le sentiment d’être les héritiers d’une tradition harmonieuse dès l’origine. Ce qui est bien entendu une tromperie de plus.
Non, en ce que, de toute façon, la franc-maçonnerie a besoin de mythes pour fonctionner, pour constituer sa culture propre. Ses allégories, ses symboles, ses emprunts à la littérature antique notamment, ont toujours quelque chose à voir avec la mythographie. Ses rituels, quel que soit le régime pratiqué, en tirent une bonne partie de leur substance. C’est d’ailleurs là un mécanisme largement répandu en dehors des loges. Toute la société, toutes les sociétés ont besoin de mythes pour forger leur conception du monde, de l’univers. Cette conception n’inclut pas que la science. La métaphysique y participe, la théologie, la fiction romanesque. Encore convient-il d’être lucide sur ce que le besoin de mythes signifie, d’une part, et sur la nécessité de distinguer les genres, d’autre part.
Par exemple, quand je lis un roman, et quand il est bien écrit, je m’immerge dans l’histoire. Mon imagination, ma sensibilité, mes émotions y trouvent leur compte. Ce n’est pas pour autant que je crois en la réalité de ce que l’auteur raconte. J’ai donc besoin du roman, en ce qu’il me fait passer un agréable moment, et je ne suis pas dupe de ce qu’il est inventé. Un bon roman aide parfois à mieux comprendre la diversité des humains qu’un long et fastidieux exposé psychologique, sociologique ou historique, mais l’intrigue qu’il développe n’est pas pour autant l’expression fidèle d’aventures ou de mésaventures vécues au quotidien par chacun d’entre nous.
Prenons un autre exemple. Les contes pour enfants ont une vertu éducative. Ils parlent de bons et de méchants, avec le bon, la belle, la brute et le truand. Les adultes les conçoivent comme des moyens de transmettre des règles morales. Ce n’est pas pourtant qu’ils demandent aux enfants de se prendre pour des petits chaperons rouges, des petits poucets, des marchandes d’allumettes, des joueurs de flûte ou des cochonnets pourchassés par le loup. Quelles que soient les formules de rhétorique employées, les parents n’ont pas l’intention de faire croire à leurs enfants que ce qu’ils leur racontent est réellement arrivé quelque part ou arrivera comme c’est dit dans le livre. Cependant, les enfants en redemandent, parce qu’ils ont besoin de faire travailler leur imaginaire et que l’imaginaire fournit alors des grilles de décodage du réel.
Je dis donc que la franc-maçonnerie appelle les mythes de la même façon. Le danger vient de ce qu’on ne sait pas faire la part des choses. La nécessité de recourir à des mythes ne justifie pas la tentation de les transformer en mensonges. Voilà en bref ce à quoi je pense : l’enfant qui écoute les mésaventures du petit Poucet, sait que c’est une histoire et il n’y croit pas ; celui qui a commis une bêtise et qui veut la masquer invente une histoire pour tromper ses parents, il voudrait bien qu’ils y croient, et son désir est le même quand il évoque une belle action qu’il n’a pas commise.
Vous voulez dire qu’il y a intention de mentir en Franc-maçonnerie ? N’est-ce pas excessif ?
Vous avez raison de me reprendre. Le mensonge peut être actif ou passif. Il peut être par mouvement délibéré ou par omission. J’ai l’impression que des auteurs contemporains savent très bien qu’ils ne devraient pas répéter en aveugle des clichés et poncifs périmés, mais la tâche est rude d’en faire un inventaire critique. Il n’y a certes pas mensonge quand, pour vanter à juste raison l’apport social ou culturel de certains grands hommes ayant été initiés dans une loge, on publie des dictionnaires à leur gloire. Cependant, l’abus de confiance guette à la porte pour deux raisons. La première est qu’on oublie souvent que la plupart de ces mêmes grands hommes auraient probablement pu avoir le même impact bénéfique sur la société ou la culture sans appartenir à une loge. Et on le vérifie sans peine quand on remarque que leur initiation est souvent postérieure au commencement de leur célébrité, comme avec Jules Ferry, Émile Littré, et j’en passe. La seconde raison est que des dictateurs, tortionnaires et criminels ont aussi appartenu à la franc-maçonnerie, et cela, on a tendance à l’oublier ou à faire semblant de ne pas le savoir.
Vous évoquez aussi la manière dont les rites se construisent. Vous prenez l’exemple du Rite français. Mais ne peut-on pas dire que tous les rites, peu ou prou, ont besoin de mythes pour fonctionner. N’est-il pas alors risqué d’en faire la critique ?
Non, pas de risque. Mon propos n’est pas de critiquer un rite dans sa logique interne, si j’ose dire. Ce qui en fait le substrat ou l’architecture n’est pas mon objet. C’est plutôt la manière dont certaines obédiences ou certains régimes en font une sorte de propriété privée qui me laisse perplexe. On le voit justement avec le Rite français dont certains chantres actuels disent qu’il est le conservatoire du rite primordial qui aurait été conçu par les Anglais au cours des années 1720. Or, ils ne prennent en considération que des catéchismes mis en forme dans les années 1780 par des commissaires du Grand Orient. Je sais bien qu’on peut trouver des similitudes entre certains passages de ces catéchismes et des divulgations faites en Angleterre au début des années 1730, mais rien ne garantit que ces passages soient bel et bien une création exclusive des francs-maçons anglais. Ceux qui le croient escamotent complètement la possible influence jacobite sur leurs compatriotes et rivaux hanovriens. Je dis « possible influence » pour ne pas verrouiller a priori un éventuel débat qui, jusqu’à présent, n’a pas été ouvert. Ce à quoi on pourrait m’objecter qu’il reste à produire des rituels jacobites pour les soumettre à une éventuelle confrontation. Mais cela ne fait pas difficulté. Je suggère pour commencer qu’on se demande pourquoi les jacobites souhaitent le port de l’épée en loge, alors que les Hanovriens le proscrivent. Et j’ai d’autres critères distinctifs à mettre en relief, bien sûr.
D’ailleurs, il ne faut pas seulement focaliser sur les loges bleues. Il y a aussi matière à beaucoup dire sur les hauts grades. On a vu reparaître récemment la pratique des Ordres de Sagesse. Là encore, il s’agit d’emprunter à des documents établis au cours des années 1780. Qui oserait se risquer aujourd’hui à dire que ces grades proviennent des loges anglaises ? Personne. Ils ont été créés en France. Mais par qui ? Les réactivateurs de ces grades évitent la question, donc aussi la réponse. Si les plus anciens d’entre eux sont déclarés écossais, ce n’est pas sous la grâce d’une inexplicable fantaisie, mais parce qu’ils ont été produits par des exilés écossais du parti jacobite, ni plus ni moins. Et, tenez, je ne résiste pas au plaisir de remarquer – de faire remarquer – que le principal intéressé à la mise en forme des grades bleus et des hauts grades au sein du Grand Orient, dans les années 1780, est lui-même un enfant de l’exil. Né dans une famille résolument jacobite, c’est lui qui orchestre, si j’ose dire, la commission. Son nom : Alexandre Röttiers de Montaleau. La plupart des documents qu’il soumet à la sagacité des Frères travaillant auprès de lui appartiennent à sa collection personnelle. Je pense qu’il en a acquis par achat ou par dons, mais il y en a aussi qu’il possède par tradition familiale. Autrement dit, même à la presque fin du siècle, les jacobites ne sont pas encore tout à fait effacés du paysage maçonnique français. Je ne comprends pas pourquoi la vulgate enseigne le contraire.
Vous abordez aussi des problèmes ou des thèmes contemporains. Surtout vers la fin du livre, vous dîtes comment vous concevez l’initiation. Un mot là-dessus pour conclure ?
J’ébauche en fait une réflexion que je pense approfondir dans d’autres ouvrages. Le travail de l’historien a ceci d’un peu sec, et d’un peu frustrant parfois, qu’il renvoie sans cesse au passé, alors que les lecteurs aimeraient aussi une étude du présent, voire une projection sur l’avenir. Encore faut-il changer d’outils. Il faut emprunter ceux du sociologue, de l’anthropologue ou du philosophe.
Disons que, depuis longtemps, bien avant que je m’intéresse au monde de la franc-maçonnerie, à son histoire et à ses pratiques, je me pose souvent la même question relative au rapport du savoir à la croyance, de la science à la foi. La plupart des philosophes depuis l’antiquité grecque se la sont posée aussi, et tous – comme moi – ont buté sur l’obstacle suivant : la science a beau viser l’universel, elle ne l’atteint jamais, elle a beau vouloir épuiser les champs du connaissable, elle n’y parvient jamais. Quels que soient les champs de leur extension, les savoirs se heurtent toujours à des limites et tout ce qui reste au-dehors de ces limites se maintient dans une sorte d’opacité. Pourtant, nous ne renonçons pas à vouloir parler de cet au-dehors ou au-delà. Nous voulons supprimer cette opacité ou en diminuer l’intensité.
Un concept fait fureur depuis quelques années : celui de complexité. Edgar Morin l’a mis à la mode. Il invite non à séparer les champs du savoir pour y énoncer des discours pointus de spécialistes, mais à les mettre en relation pour qu’ils se fécondent les uns les autres, en tâchant alors de comprendre au mieux la complexité du réel même. L’inter ou la transdisciplinarité sont obligés pour quiconque nourrit le projet de construire le savoir le plus complet possible des êtres et des choses de ce monde. Mais personne ne peut aujourd’hui se targuer de maîtriser toutes les sciences disponibles, Edgar Morin n’y prétend pas lui-même, et dans l’hypothèse où un génie s’éveillerait parmi nous avec des facultés supérieures, il ne le pourrait pas non plus. J’ajoute que je ne crois pas davantage à la fabrication d’un super ordinateur qui pourrait le faire un jour. C’est là un autre genre de mythe qui plaît aux amateurs de science-fiction. Non, comme disait Blaise Pascal, il n’y a pas que le silence effrayant de l’infiniment petit et de l’infiniment grand qui crée un obstacle puissant à la mise en discours théorique, ce qui est donc l’ambition de toutes les sciences, il y a aussi et avant tout les mystères des émotions, des sentiments, des plaisirs et désirs, des affinités électives. Il y a l’énigme de la vie et de la mort. Il y a les dérives de l’irrationnel.
Telle qu’elle est maintenant conçue, l’initiation me paraît alors une démarche possible pour découvrir des traits de lumière sur ce que le savoir discursif ne peut ni ne pourra jamais appréhender, pour se familiariser à petits pas avec l’autre complexité qui reste indéchiffrable à notre entendement. En cela, l’initiation se distingue des religions par le fait que celles-ci fournissent un dogme préétabli et supposé valable pour tous les adeptes. L’initiation est toujours l’acte d’un individu singulier, inassimilable à aucun autre, qui ne peut découvrir que par lui seul ce qui fonde le sens de ses propres engagements.
J’anticipe sur l’objection que vous pourriez me faire : ce que je dis ici de l’initiation reste très sommaire. Certes ! Je crois qu’il me faudra un livre entier pour développer mon point de vue. Disons pour le moment que l’initiation est un processus d’accès à l’altérité, en ce qu’elle fait devenir autre. Or, on n’apprend à devenir autre, c’est-à-dire à se transformer, à s’améliorer, qu’en fréquentant d’autres que soi, dans un lieu autre, presque dans un temps autre, en admettant comme inévitable et enrichissante la rencontre de l’autre, pourvu que lui-même reste autre, tout en cheminant aussi sur sa pente initiatique. Le but est alors aussi un autre genre de savoir que celui communément partagé, c’est l’autre du savoir, l’outre-savoir, si je peux jouer sur les mots, un peu comme on dit outre-mer. Même s’il ne peut en faire la théorie, et surtout parce qu’il ne peut pas la faire, l’initié en arrive à sentir, deviner, intuitionner, ce qui confère de la valeur à ce qui reste en deçà ou au-delà du langage, donc de la logique ou du dogme.
Je suis sans doute plus suggestif en ajoutant ceci : l’apprentissage de la tolérance est réussi quand on s’aperçoit qu’on ne peut pas tout savoir, que ce qu’on découvre au-delà du savoir vaut pour soi-même mais pas pour tout le monde, peut-être pour quelques-uns mais pas pour tous, et qu’on accepte de s’en satisfaire. Que sais-je ? Se demandait Montaigne. L’initié est celui qui s’aventure dans ce qu’il ne sait pas pour y trouver quelques clairières de sens, qui aident à compenser son ignorance et à vivre en bonne intelligence avec autrui.


